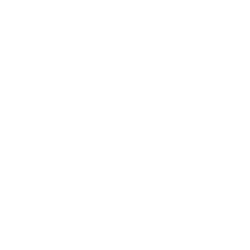La question semble ridicule. Chocolat, dinosaures : impossible d’envisager les deux ensemble. Bien sûr, si les dinosaures étaient restés les maîtres de la planète, les humains ne seraient pas apparus – en tous cas sous leur forme actuelle. Donc, nous n’aurions pas été là pour fabriquer le chocolat. Fin de l’histoire. Enfin, pas vraiment…
L’impact météoritique qui a entraîné la disparition des dinosaures a provoqué de nombreuses répercussions sur notre planète. En effet, en décimant de nombreuses espèces animales et végétales, de nombreux écosystèmes ont été complètement remodelés. Ainsi, il se pourrait que la catastrophe ait bénéficié d’une façon inattendue au cacaoyer…
Vin, chocolat et dinosaures, une même histoire ?
L’enquête commence en Amérique du Sud, avec une équipe de paléobotanistes. Un chercheur américain, Fabiany Herrera, est à la recherche d’un fossile aussi mythique qu’insaisissable. Celui du grain de raisin… Difficile à trouver au milieu des roches de par sa taille, précieux, car permettant de retracer l’histoire de cette plante emblématique pour l’humain qu’est la vigne.
En 2022, Fabiany et ses collègues font une percée dans les Andes colombiennes. Ils y découvrent un fossile particulièrement ancien. Pour confirmer qu’il s’agît bien de raisin, c’est au scanner médical qu’ils sondent leur trouvaille pour en révéler la structure. Poursuivant leurs efforts, ils parviennent à identifier neuf nouvelles espèces de raisin à travers l’Amérique du Sud, remontant entre 19 et 60 millions d’années. Ce travail leur permet de brosser le tableau de l’évolution de cette plante sur ce continent.
Ainsi, ils expliquent qu’avec la disparition des dinosaures, les forêts changent drastiquement. La croissance des arbres n’est plus ralentie par ces géants qui façonnaient les forêts à leur passage. Elles deviennent de plus en plus denses. C’est pourquoi, la lumière devient aussi de plus en plus difficile à atteindre pour de nombreuses plantes. A défaut de pousser assez vite, certaines espèces développent de nouvelles stratégies . Ainsi, la vigne grimpe pour gagner en hauteur et en exposition à la lumière. De même, ses fruits sont facilement disséminés grâce aux oiseaux, ce qui lui permet de coloniser de larges régions.

Et le chocolat alors ?
Ce changement d’environnement a aussi certainement affecté le cacao préhistorique et pourrait expliquer les caractéristiques actuelles des cacaoyers. En effet, malgré le fait qu’il soit une plante tropicale, le cacaoyer n’est pas adapté aux environnements en plein soleil. Bien qu’atteignant 12 à 15 mètres à l’état sauvage, sa hauteur n’est pas suffisante pour concurrencer les espèces plus grandes. C’est donc un arbre ayant besoin de conditions ombragées. Un héritage peut-être venu de ces forêts sans dinosaures.
Pour compenser la manque de lumière, le cacaoyer tire du sol une partie de l’énergie dont il a besoin. C’est pourquoi il nécessite des sols riches. Ces caractéristiques en font un arbre fruitier peu adapté à l’exploitation intensive. Ainsi, en monoculture, il épuise les sols, qui après quelques années ne sont plus fertiles. De même, pour l’exploiter, il aura fallu un important processus de sélection pour les rendre plus résistant au soleil direct. Mais si la variété industrielle, appelée CCN51, permet de planter du cacao sur des parcelles défrichées, elle ne répond pas aux problèmes de l’épuisement des sols. Sans mentionner les ravages liés aux parasites et autres champignons qui prolifèrent sur ces parcelles à faible biodiversité, et rendant les cultivateurs dépendants des fongicides et des engrais.
Finalement, les meilleurs cacaos sont issus de l’agroforesterie où la symbiose avec d’autres espèces permet un bon équilibre. Au-delà des aspects environnementaux, ces cacaos sont aussi souvent plus riches d’un point de vue gustatif. De quoi nous encourager à cultiver l’héritage légué par un certain astéroïde, qui, il y a environ 65 millions d’années, changeait la donne pour le cacao… et les humains.
Crédit photo image principale : Silvana Mool.